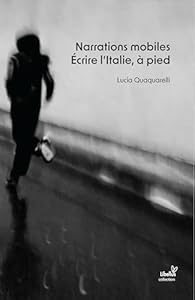
Lucia Quaquarelli, Narrations mobiles: écrire l’Italie, à pied
Paris ouest, PU Paris Nanterre, Libellus collection, avril 2025, 278 p.
Pour l’envoi de ce livre, je remercie Les éditions Paris ouest, PU Paris Nanterre ainsi que Nicolas de l’équipe Babelio.
Ceci n’est pas un guide touristique ni un récit de voyage mais un essai qui analyse toutes les formes de narration (au sens le plus large donc) qui ont rapport avec la marche à pied : un procédé qui parcourt lentement, écoute abondamment, raconte la subjectivité de chacun·e, rend compte d’un état des lieux sociétal, critique l’urbanisme politique, guide d’une autre manière… Hybride, il se situe entre géographie, sociologie, psychologie, politique…et voyage, initiatique, explorateur, remémoratif…
Le « droit à la ville » (car il s’agit ici de lieux urbains) s’impose comme le droit de participer, le droit d’« habiter » à part entière, par le « droit au passage » (p 231).
Des écrivains et écrivaines réinscrivent la narration comme pratique sociale, critique et structurante depuis, dans, pour le réel (p 174) et créant du réel (p 233). Ils et elles sont en passe de produire sinon un nouveau genre littéraire (p 234) mais une tendance manifeste, de l’ordre de la psychogéographie (p 94) regroupant de nombreux adeptes tant dans l’édition que dans le lectorat.
Cet essai demande la connaissance d’un vocabulaire approprié et une attention soutenue. Mais après un temps d’ajustement à la pensée de l’universitaire et à son mode d’écriture, la démonstration se fait plus explicite. Sur ce point (le mode d’écriture/la structure du texte/la présentation de l’essai), je me demande s’il n’aurait pas été plus fluide d’insérer la traduction dans le texte français en mettant la citation originale en bas de page plutôt que l’inverse qui conduit à un va-et-vient, cassant le rythme de la lecture, et ce, sans vouloir enlever de la prédominance à l’italien (essentiellement) ni de l’authenticité ? (J’avoue que mon habileté dans cette langue est un peu engourdie pour me passer de cette aide).
Il convient ensuite de s’accorder à la prise de position de Lucia Quaquarelli qui annonce d’emblée qu’elle utilisera une écriture inclusive, dégenrée, des mots épicènes et des accords de proximité « pour parler, et écrire, à plusieur·es » (p 25).
Sur ce thème, je recommande également Edgardo Scott, Du Flâneur au vagabond : Un essai littéraire sur la marche (chroniqué ici) qui met en valeur, lui aussi, une autre façon d’être au monde.
Pour ce dernier, il y en a cinq. Pour Lucia Quaquarelli, il y en a trois : exploratoire (p 102), « solivaguante » (p 104) et critique (p 108). L’écrivain·e devient « performeur » (p 143) d’une contre-narration (p 174) afin de désaveugler le touriste et le résident sur l’emprise hiérarchique et patriarcale de la construction urbaine.
Le partage des thèmes, des modalités de création et des dispositifs de narration est le lien qui unit les « écrivains-marcheurs » dans la recherche de la décélération (p 241), de la reprise en mains des sensations et des priorités, d’échapper à l’empire d’un urbanisme réducteur.
Citation(s):
– p 81 : « […] des textes littéraires, trop souvent réduits, hélas, à répertoire de témoignages, réserves d’informations ou encore inventaires des visions subjectives “au service” des autres savoirs. »