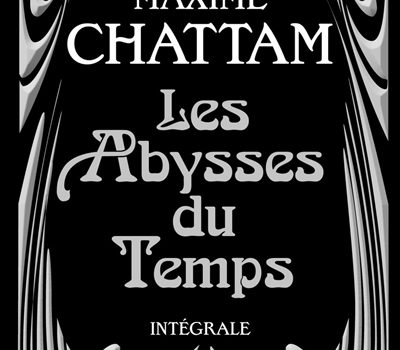
Maxime Chattam, Requiem des Abysses
L’intégrale réunit les deux enquêtes du criminologue et romancier Guy de Timée.
Disons tout d’abord que ce n’est pas à cause d’une sensiblerie inopportune pour ce genre de lectures que la surenchère d’horreurs peut finir par lasser au lieu d’intéresser.
Âmes sensibles ou cyniques, s’abstenir donc.
Lorsque j’ai commencé l’intégrale des Abysses du Temps, je ne savais pas si j’allais poursuivre après Léviatemps jusqu’au Requiem du temps. Mais ma curiosité m’a poussée, non pas comme la petite Alice vers le pays des merveilles, mais plutôt au pays de l’horreur. Puis je me suis extraite du trou dans lequel tombe l’innocence, depuis le fond des abysses, m’agrippant aux raisonnements de Guy chez lequel j’ai imaginé beaucoup de Maxime.
La psychologie du crime et les arcanes de la part obscure de chacun m’ont en effet intriguée quand bien même les bases de l’inconscient sont à présent bien connues (merci Freud!). Elles s’avèrent répétitives et systématisées (manque de repères familiaux/maltraitance infantile, perversion sexuelle/impuissance, idolâtrie compulsive, etc.). On en connait les conséquences : infamie, abjection, cruauté, etc., et les réactions qu’elles induisent : répulsion, terreur, cauchemars, etc. Dans ces deux opus, le style emploie l’ensemble du vocabulaire adéquat de base (avec quelques mots de niveau supérieur : anhéler (haleter), animadversion (blâme), etc., et des verbes fétiches (égrener…) mêlé à une tonalité mélodramatique moins surprenante que les accents lyriques, voire poétiques, qui émaillent parfois le récit. Le texte présente souvent des phrases courtes et des alinéas fréquents. Cette ponctuation scande l’épouvante en structurant le texte de manière brusque et frappante tandis que l’argument psychologique et symbolique développe de longs paragraphes qui font la part belle à l’intuition.
On dit que la curiosité est un vilain défaut. Je ne le crois pas. En tout état de cause, la mienne m’a aidée à terminer ce dyptique. La France des années 1900, l’exposition universelle de Paris (où se bouclent les enquêtes après un passage dans le Vexin) ont fait partie de l’intérêt que j’ai porté à cette intrigue avec l’encart photographique illustrant une période charnière de l’évolution dans la société. Et c’est un point intéressant dans ce panorama : si la « mise en garde » avertit que le narrateur va écrire et que l’ « épitaphe » se termine par le fait qu’il a écrit, le prologue commence par la fin alors que l’épilogue revient au début, effectuant ainsi une pirouette qui s’enroule comme un tourbillon d’horlogerie.
Un siècle passe : celui de la mutation sociale que les deux enquêtes ont tenté d’explorer par le symbolisme du temps (horloge humaine (1er livre) et résurrection dans la chair (2ème livre). La conclusion est, bien entendu, très pessimiste et justifie le titre : Requiem des Abysses, soit une liturgie pour les défunts.
Et c’est pourquoi, disons à la fin qu’il nous reste à espérer que, comme le narrateur nous ayons « la capacité de descendre dans les abysses et d’en remonter indemne » (p 660), ce qui permettrait « de suivre ces individus qui s’y sont perdus » (Ibidem) et en cela « servir ; ouvrir des pistes de réflexion ! » (Ibid). Quant à la définition du mal, je la laisse découvrir à ceux qui liront jusqu’à la page 1139.
Citations:
– p 729 : « Le fil rouge de sa pensée. / La raison même qui le poussait à écrire une histoire aussi diaboliquement macabre. / Tout l’art serait dans le dosage. Que les péripéties ne noient pas le sous-texte, et que ce dernier ne dissolve pas les premières. / L’équilibre du roman noir. »
– p 1109 : « Les hommes […] remplissaient l’estomac d’une ville assoiffée de lumière au point d’en vider les entrailles de sa Terre, et d’asservir ses enfants. »