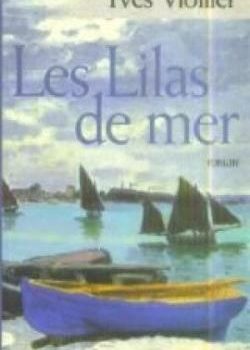
Yves Viollier, Les Lilas de mer
2002, éd France Loisirs, 359 p.
1892 : Jean Guéry, un jeune prêtre arrive dans sa nouvelle paroisse en même temps que des étrangers venus d’Italie, de Corrèze et du Limousin pour construire la digue qui protégera les cultures des tempêtes.
Roman de terroir vendéen : les paysages plats à reconquérir sans cesse sur la mer, l’évocation de la terre, du sable, de l’eau, des vases, des étendues de ciel et du souffle des vents transportent dans une région où la magie émerge grâce à l’auteur.
Si l’injustice tragique qui frappe Jean-Marie et La Mularde n’est (malheureusement) pas exceptionnelle, le fait que ce soit le curé qui rétablisse la vérité l’est. Il sera puni pour avoir « mélangé » le sacré et le profane, aussi bien par sa hiérarchie et par les paysans qui pensent que ce n’est au curé de rétablir la justice sur terre.
De multiples barrières se dressent ainsi entre les étrangers et les locaux, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, mais, aussi affligeant, entre la justice humaine et la justice « divine ».
En effet, la jalousie et la vengeance se sont perpétuées de génération en génération dans la même famille. Alliées au mensonge collectif (par omission) de la population, elles ont rendu complice le village silencieux.
Le prêtre fait en sorte que la vérité soit rétablie et lutte pour que ce que sa mission d’évangélisation du pays ne soit pas un leurre. Il vivra son douloureux constat sur les âmes humaines entre grandeur et misère comme un échec.
C’est lui qui écrit ce témoignage. Avec des mots et des phrases simples, il justifie son action et rend compte de la vie laborieuse d’une région exigeante à un moment donné de son histoire : le début du XXe siècle.
Le titre « Les Lilas de mer » est annoncé par le péritexte. Si le lilas (sans majuscule) est une plante vivace de bord de mer, Lilas est le prénom métaphorique de la femme qui vit, comme elle, sur les côtes. Ce nom sera ensuite donné au bateau (chap. III, p 120).
Empreint de liberté sauvageonne, de beauté originale, noble et rustique à la fois, aux « vertus toniques et astringentes » (p 9), le lilas de mer devient emblématique de la femme qui porte son nom et qui déclenche, de la même manière involontaire que sa mère l’a initié des années plus tôt, le conflit actuel.
Le curé qui s’occupe de son jardin et de ses dahlias en particulier qui, comme lui, seront déracinés et replantés (pp. 109, 228, 356). Et à la toute fin (de sa vie et du livre), il « imagine le paradis comme une dune fleurie de lilas et de dahlias au bord de la mer ».
Citations:
– p 108 : « L’air embaumait les lilas de mer que Lilas cherchait dans le sable. Si elle apercevait une bouillée de la fleur bleue, elle cueillait toute la gerbe et y enfonçait le visage. Jean-Marie en approchait le nez, humant à la fois la fleur et sa femme, il murmurait : / — Lilas ! Lilas ! »
– p 16 : « La forêt prenait à mi-côte et s’étageait jusqu’au sommet de la colline. Il s’y enfonça sans hésiter et éprouva une curieuse sensation de sécurité dans sa grande ombre. »
– p 109 : « En entretenant mon jardin, je me rapprochais de mes paroissiens. Je voyais leurs yeux rire lorsqu’ils me trouvaient le rabat de travers, poussant une brouette de mauvaise herbe ou de pomme de terre. Tout de suite ils engageaient la conversation, et nous parlions des mêmes choses. »