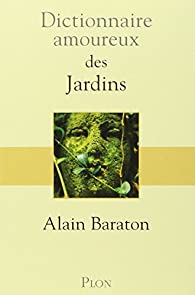
Alain Baraton, Dictionnaire amoureux des jardins
PLON 2012, 592 pages, numérique 415 p.
La particularité de ce dictionnaire réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’un lexique exhaustif de termes, d’une liste rébarbative de noms ou de citations pompeuses.
L’auteur se promène en toute liberté dans ses souvenirs comme dans ses jardins favoris, au cœur de ses émotions comme parmi ses connaissances.
Il nous fait profiter de ses anecdotes sympathiques, de ses engagements écologiques et de ses références personnelles tant littéraires, picturales que savantes formulées avec simplicité.
Nous voyageons ainsi dans l’histoire, parcourons la géographie et les styles, apprenons les découvertes des botanistes et des paysagistes, des plus connus aux moins connus mais tout aussi intéressants.
Alain Baraton avoue : « J’ai ainsi rédigé mon livre comme je crée un massif, en sélectionnant les éléments de composition avec soin et en me laissant porter par mes sentiments » (p 7).
Les amateurs d’art seront séduits par les dessins finement ciselés émaillant le dictionnaire. Toutefois, Alain Baraton en parlant d’Hergé qui, pour ses albums de Tintin a dessiné le château Moulinsart en prenant pour modèle celui de Cheverny, déclare : « Quand on a la chance d’être aussi doué pour le dessin, à quoi bon se borner à recopier la réalité ? Où est l’esprit créatif, l’imagination le délire ? Si j’avais su manier le crayon aussi bien que lui, j’aurais inventé des jardins extravagants, des arbres incroyables, des paysages inconnus » (p 93). La déception de l’auteur s’explique lorsqu’on sait qu’il est depuis trente ans, le jardinier en chef des jardins de Trianon, du Grand Parc de Versailles et depuis 2009 en charge du domaine de Marly.
Les littéraires seront ravis de lire les “Dictons, maximes et autres proverbes” (p 123), les « phrase[s] simple[s], courte[s], mais belle[s] » des « personnalités [qui] ont exprimé leur attachement au jardin » (p 193) et les références polyculturelles de l’auteur.
Concernant l’article “Jardinière”, je comprends qu’il y ait des détracteurs de l’écriture inclusive et de la féminisation des métiers – toute innovation dans la langue étant plus longue à prendre racine qu’un arbre lui-même (voir mon article à ce sujet en cliquant sur ce lien). Mais si l’auteur est mal à l’aise avec l’appellation de “jardinière” pour une femme travaillant dans ce domaine, car le mot a été appliqué antérieurement à des parterres ou des pots de fleurs, un plat légumier ou un grand magasin qui a disparu en 1972 – et j’en suis la première d’accord – , sa proposition d’ajouter des termes tels que “jardineuse” ou “jardiniste” (p 194) reste sans nul doute très hypothétique.
Enfin quant à tous les amateurs de jardins, ils ou elles sauront apprécier la passion de l’auteur qui se partage avec plaisir en papillonnant dans les allées de sa curiosité.
NB : Ce livre a été ajouté à la bibliographie concernant mon “écrit en cours” (à lire dans la rubrique « Projets »).
Citations :
– p 7 (L’exergue) : « les amateurs de jardin sont réputés paisibles. On imagine mal échangeant des coups de sécateur, même lorsqu’il s’agit de trancher entre le naturel, qui dissimule autant que possible l’intervention de l’homme, et l’invention de toutes pièces qui la revendique comme sa fierté. Cette querelle est aussi ancienne que les princes babyloniens ; elle dure et durera parce qu’elle n’est rien d’autre que la continuation sur un autre terrain, sur la terre même, de la plus opiniâtre des guerres philosophiques, celle qui oppose les zélateurs de la Nature – au fond, les croyants à une « nature humaine » – et les sceptiques, adepte de l’artifice… »
Pierre Veilletet, Le vin, leçon de choses, Arléa, 1994.
– p 16 : « Un jardin, c’est une chose supérieure, c’est une mosaïque d’âmes, de silences et de couleurs, qui guettent les cœurs mystiques pour les faire pleurer. Un jardin, c’est une coupe immense aux milles (sic) essences religieuses. Un jardin, c’est quelque chose qui vous étreint avec amour, c’est une paisible amphore de mélancolies. Un jardin c’est un tabernacle de passions, c’est une grandiose cathédrale pour de très beaux péchés. Dans les jardins se cachent la mansuétude, l’amour, et cette sorte de vague à l’âme que donne l’oisiveté. »
Federico Garcia Lorca. »
– p 17 : « Jusqu’à la fin du XIXe siècle, il était de bon ton d’étaler sa richesse et celle-ci s’exhibait avant même les grilles de la maison. Les arbres participaient de cet étalage. Dis-moi ce que tu plantes, je te dirai qui tu es. »
– p 17 : « Les anciens plantaient des arbres très rapprochés, ce qui est contraire à toutes les règles botaniques, pour donner l’illusion d’une allée interminable. »
– p 83 : « La chaise longue est née. Elle connaît son apogée dans les années 1960 […]. La chaise longue fait place maintenant au lit de jardin. La fainéantise a encore de beaux jours devant elle. »
– p 193 : “Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut.” Cicéron.