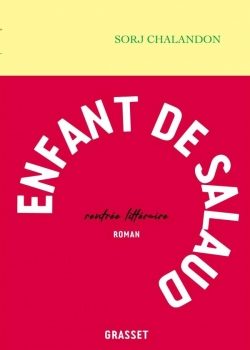
Sorj Chalandon, Enfant de salaud
2021, Grasset, 336 pages.
Livre reçu dans le cadre du Prix Landernau 2021, auquel j’ai participé en tant que jurée.
Je remercie La Communauté Culturelle Leclerc ainsi que les éditions Grasset.
Dans une confrontation père-fils menée en parallèle avec le procès de Klaus Barbie (accusé de « Crime contre l’humanité en 1987 »), Sorj Chalandon couvre l’événement judiciaire et historique en tant que journaliste pour le journal « Libération ». Il reçoit le Prix Albert Londres en 1988.
Je n’ai pas lu Profession du père. Mais il semble bien que dans Enfant de salaud, l’auteur poursuive sa quête de la vérité. Il tente de se (re)construire en démêlant les mensonges et les manipulations qu’il a subis, entre le mythe et la réalité d’un père, soit tout puissant, soit d’une faiblesse pathologique.
Deux histoires se jouent : celle du « bourreau de Lyon » et celle d’un fils face à un père, qui assistent tous deux au procès, chacun dans coin, chacun de son côté, chacun sous son angle. Alors que les témoignages se poursuivent en l’absence ou en présence forcée de l’accusé, un autre accusé se meut, libre de venir ou pas, sous l’œil acéré d’une autre justice, familiale celle-ci. Le parallèle est éreintant. Le voyage à rebours imprime un tourbillon aux lieux, dates, couleurs d’uniformes et de bannières, aux émotions fragiles ou féroces.
Depuis qu’il a entendu qu’il était « un enfant de salaud » de la bouche de son propre grand-père, l’enfant a grandi, ne sachant si son père était collabo, pétainiste, traitre, dénonciateur, déserteur, assassin peut-être, ou bien résistant infiltré, héros de guerre, Ranger, ou encore opportuniste, fou de rêves de gloire, mythomane ? Jusqu’à décider de modifier son prénom (Georges) en Sorj, parce que c’était celui que lui donnait sa grand-mère.
Le passé paraît hanter les écrivains tels que Modiano (Chevreuse), Jaenada (Au printemps des monstres) et Chalandon. Et comme je l’ai dit pour Patrick Modiano (ici) et Philippe Jaenada (ici) : « la période trouble de la guerre et de l’après-guerre n’a pas fini de faire remonter les crimes des défunts et de raviver les blessures des vivants ». La « petite histoire » s’apparente à la « grande histoire », avec des acteurs effroyables, des thématiques obsédantes. Les convictions sont ébranlées et l’émotion est palpable. Pour les spectateurs du procès comme pour le fils, spectateur du récit paternel, la colère bout à mesure que l’atrocité progresse. Pour les lecteurs du livre, la contagion et la dissociation alternent avec une pondération glaçante.
Le narrateur ne veut pas « tuer le père », ni au sens propre, ni au sens figuré. Il veut éclaircir une image floutée. Il veut s’accrocher à du réel pour bâtir un passé sur des bases qu’il pourrait défendre (ou pas), mais qu’il pourrait affronter tout du moins. Il ne cherche pas la vengeance, mais la vérité sur son héritage comme une justice rendue à sa mémoire. En sera-t-il apaisé ? Il le croit. Porte-t-il préjudice à son père ? Il n’en est pas conscient. Il est si blessé qu’il est obnubilé par la confession des faits/des fautes. Il appartient aux « dommages collatéraux » qui n’ont pas fini de se penser et de se panser dans l’espoir de guérir. Le père est-il plus malade que mystificateur ? Doit-on envisager qu’une incapacité psychique/mentale prend le pas sur sa raison ? Et que la blessure du fils, qui n’est pas que d’amour propre, mais d’amour tout court envers cet homme qui a trahi ses responsabilités de père (entre autres) doit s’effacer ? Le débat divise les sensibilités et la critique. Le malaise est réel, quoi qu’il en soit.
Tout au long du roman, le père n’est pas montré comme déficient intellectuellement. Au contraire, il se sort de toutes les situations les plus hasardeuses. Si handicap psychique il y a, l’auteur provoque de l’empathie envers le fils, non pour le père. Son insistance peut paraître égoïste, voire dénuée de scrupules. Pourtant, il se montre patient à bien des égards, respectueux même et incapable de révolte physique contre son géniteur. Il attire la compassion des lecteurs sur le côté visible des événements (celui qu’il a connu) sans laisser entrevoir de partie obscure, celle d’une maladie mentale, qui serait la raison de l’incompréhension générale. Une cause qui n’a pas été détectée avant longtemps et pour laquelle on se demande quand le père a été interné ? L’information est en effet donnée à la toute fin, sans préciser qui a décidé de cet internement, ni à quelle date, ni selon quel diagnostic. Cette sorte de prologue installe un nouveau trouble : est-ce la preuve irréfutable de sa maladie ? Ou la preuve d’une manipulation du système ? Est-ce la fin de la dérive d’un homme qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal ? Est-ce le fils qui a fait ce choix suite à la dernière « traversé[e de s]on lac allemand » ? (p 330).
Le roman ajoute à l’autofiction, non pas dans le fond (c’est la même quête), mais dans la forme : la réalité factuelle est transposée (l’ouverture du dossier du père de Chalandon en 2020 est postérieure au procès de Barbie), recomposée dans un dialogue imaginé, souhaité mais impossible (son père étant décédé en 2014) : “Tu m’aurais avoué tout ça, le soir, en confident secret. Peut-être n’aurais-je pas compris, mais tu m’aurais parlé, enfin” (p 261).
Entre un fils en souffrance qui tend la main à un père qui ne veut/peut pas le consoler, la fin est un lâcher prise sur une note métaphorique d’espoir : « tu m’attends de l’autre côté » (p 330).