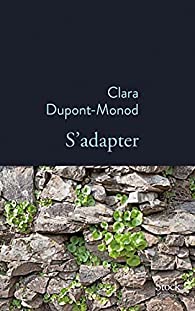
Clara Dupond Monod, S’adapter
2021, Stock, 171 p.
Livre reçu dans le cadre du Prix Landernau 2021 auquel j’ai participé en tant que jurée.
Je remercie La Communauté Culturelle Leclerc ainsi que les éditions mentionnées.
Ce roman a décroché le Prix Landernau des lecteurs 2021 et figure sur les listes du Goncourt, du Femina et de l’Interallié.
Un titre simple pour un roman clair. Bien qu’il ne fasse pas l’unanimité (le peut-on jamais?), ce roman a bouleversé une grande partie de son lectorat. On pourrait sourciller éventuellement sur le thème traité : le handicap n’est pas un sujet nouveau dans la littérature. On pourrait épiloguer sur une très grande sensibilité que d’aucuns verront comme du pathos. On pourrait ne pas être convaincu par le procédé des pierres qui parlent. Mais chacun de ces “reproches” semble finalement faire la force de l’ensemble.
Le cataclysme provoqué par l’arrivée d’un enfant “différent” est un sujet bouleversant. il est hélas toujours d’actualité. l’originalité de S’adapter est d’aborder la souffrance du point de vue des enfants. Les parents restent à l’arrière, heureusement unis et assumant leur charge. Le frère et la sœur vont réagir différemment, à l’opposé l’un de l’autre avant que le troisième ou plutôt le quatrième vienne rendre de la cohésion à la famille. Le lecteur et la lectrice s’attachera à l’un ou à l’autre, selon sa sensibilité et son vécu. l’absence de prénom facilitera cette identification en rendant ces protagonistes universels : ils ne sont désignés que par leur place dans la fratrie.
Trois parties nous présentent l’aîné et l’amour qu’il voue sans condition à son frère, la cadette dont la jalousie provoque tout d’abord la révolte puis le courage de sauver la “famille en péril” (p 111)…et le petit dernier souffrant de l’ascendance d’un frère disparu, qui lui manque à la façon d’un “membre fantôme”, un syndrome bien connu. La grand-mère veille : « Si un enfant va mal, il faut toujours avoir un œil sur les autres” (p 94).
“L’enfant” désigné comme tel et qui le restera est né avec une maladie qui n’est pas nommée, un très lourd handicap qui le rend végétatif. Il accapare toute l’attention, aspire toute l’énergie de son entourage provoquant honte, dégoût et rejet, mais aussi amour, compréhension et dévotion. Sans s’appesantir sur les attitudes plus ou moins empathiques ou méprisantes, Clara Dupond-Monod distille la tristesse et l’espoir avec des mots simples, directs, parfois tendres ou durs. C’est un hommage à la différence et un hommage à ceux qui l’acceptent.
La ressemblance entre l’aîné et l’enfant “était frappante” , “le même profil, front […], nez[…], menton[…]. Et les yeux[…], les cheveux[…], la bouche[…]. Se tenaient devant elle, dans la salle de bains, l’original superbe et la réplique ratée, un dédoublement malheureux”( p72). Est-ce cela qui a provoqué une empathie fusionnelle de l’aîné envers son petit frère? ne dit-il pas : “c’est moi qui suis inadapté”(p50). l’enfant immobile appelle au calme et au silence, l’aîné se met en retrait vis-à-vis de la brutalité de la vie et de la société où les faiblesses sont toujours sanctionnées. il s’occupe de l’enfant comme d’un vieillard (p 40) en inversant les rôles (p 40). Sa sœur fera de même en s’occupant de lui plus tard comme l’adolescent qu’il est resté: “Elle l’avait peut-être perdu; mais au moins avait-elle récupéré son fantôme” ( 99).
L’histoire de cette famille prend place au cœur des Cévennes, raconté par de magnifiques descriptions et par les “petites pierres rousses” qui forment le muret du jardin. À chaque “intervention “des narratrices” (les pierres), on peut se poser la question : qui parle ? Pourtant, le parti-pris semble fonctionner en donnant un côté intemporel, objectif et serein à cet angle de vue. On connaît les dictons populaires tels que : “si les pierres pouvaient parler”, “les arbres se souviennent”, “les murs seront témoins”, etc., accordant une mémoire omnisciente à l’immuabilité de certaines choses. On peut ne pas adhérer à cette approche, mais loin d’être “simpliste”, elle assure un recul qui dédramatise en donnant une âme à un présent difficile. Faire parler les pierres ramène le récit à une sorte de sagesse populaire, mi-fable, mi-conte.
Ce texte manie intensité et légèreté, de la délicatesse dans le style et de la poésie dans les émotions. Enfin, une élégance dans l’écriture sachant gérer ces contradictions avec subtilité.
L’amour n’est pas un but (p 50), mais un fait. La cruauté des vivants et la normalisation par le progrès s’opposent à cet enfant sans avenir. Si dans un premier temps, la force de son inertie détruit autour de lui (p 74), elle change les rôles : “Il sentait bien que ce n’aurait pas dû être son rôle. Mais il sentait aussi que le sort aime défaire les rôles, et qu’il fallait s’adapter” (p 126).
La photo prise à la fin montre un couple et ses quatre, et non pas trois, enfants restés unis. Une photo de famille et de son histoire.