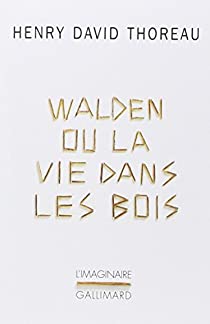
Henri David Thoreau, Walden ou la Vie dans les…
1990, Imaginaire Gallimard, lu en numérique, 358 p, titre original : Walden; or, Life in the Woods.
M’intéressant à l’élément végétal dans la littérature (voir essai ici) j’ai été amenée à lire Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson (lire ici), qui m’a rappelé Into The Wild de Jon Krakauer (lire ici). De fil en aiguille, je me suis penchée sur le mouvement Nature Writing dont les origines remontent à ce livre d’Henri David Thoreau, aux États-Unis en1854.
Walden ou la Vie dans les bois marque en effet le début d’un genre littéraire dont on peut encore voir les traces aujourd’hui. Ce récit est en partie biographique mais pas seulement : les réflexions que l’auteur tire de son exil volontaire relèvent de l’ordre philosophique et confèrent au rousseauisme. Démontrant par son retour à la nature ses idées de manière concrète, et tout en se plongeant dans une méditation autocentrée, Thoreau joue au robinson pour attirer l’attention.
Justifiant l’essentialité de l’homme, il récuse principalement les règles instaurées par l’état et la société (L’épisode de l’impôt sur la propriété est particulièrement parlant). Cependant, il n’est ni naufragé (il bâtit sa cabane non loin de sa ville natale), ni ermite (il voit ses amis et reçoit de nombreuses visites). Il choisit de vivre cette expérience pendant exactement de deux ans, deux mois et deux jours, à partir de la date de déclaration de l’indépendance des états unis, symbole d’une liberté retrouvée.
Le texte en lui-même recèle plusieurs voix : narrative, lyrique, poétique et la phraséologie peut apparaître un peu désuète pour des lecteurs du XXIe siècle. Plusieurs genres littéraires s’entremêlent et donnent à cet « essai » un caractère composite mais achevé. Ce n’est pas une confession – plus ou moins sincère – écrite sur un journal quotidien, la structure en chapitres renvoie à une élaboration réfléchie. C’est un pamphlet contre la société de consommation occidentale qui réclame une conscience environnementale accrue et alerte sur les dangers du « progrès ». Ce texte amorce une prise de conscience qui restera en lien avec des écrits écologistes de plus en plus virulents.
J’ai retrouvé certains traits rencontrés chez Tesson et Krakauer en plus “modernes”, qui révèlent en revanche une sensibilité égale envers la nature et une profonde déception vis à vis d’une société de consommation galopante.
Citations :
– p 9 : « Ce que l’on appelle résignation n’est autre chose que du désespoir confirmé. »
– p 10 : « Nulle façon de penser ou d’agir, si ancienne soit-elle, ne saurait être acceptée sans preuve. »
– p 26 : « Ce qu’il faut aux hommes, ce n’est pas quelque chose avec quoi faire, mais quelque chose à faire, ou plutôt quelque chose à être. »
– p 105 : « Dit le poète Mir Camar Uddin Mast : « Étant assis, courir par les régions du monde spirituel ; j’ai connu ce privilège dans les livres […] ». »
– p 107 : « Mais l’écrivain, […] parle à l’intelligence et au cœur de l’humanité, à tous ceux qui de n’importe quelle génération peuvent le comprendre. »
– p 138 : « Je crois que les hommes ont en général encore un peu peur de l’obscurité, malgré la pendaison de toutes les sorcières, et l’introduction du christianisme et des chandelles. »
– p 203 : « Ma muse peut être excusée de se taire désormais. Comment espérer des oiseaux qu’ils chantent si leurs bocages sont abattus ? »