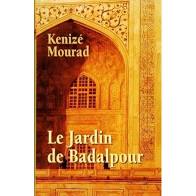
Kénizé Mourad, Le jardin de Badalpour
1998, Le Grand Livre du mois, 554 p.
Zahr veut retrouver ses racines : Selma, sa mère est une descendante des sultans. Elle est morte à Paris dans la misère. Son père est un radjah de Badalpour qui survit dans la partie musulmane de l’Inde, affaiblie par l’indépendance.Zahr rejoint son père et son pays d’origine. Malgré son identité retrouvée, elle se confronte à une dure réalité, bien loin du conte de fées et de l’opulence de l’Inde rêvée :
” Le palais de Lucknow est un bâtiment de pierre aux colonnes majestueuses, bâti à l’époque de la domination britannique. De loin, ce temple du Droit en impose, mais, sitôt franchies les grilles qui l’isolent de la rue, on se trouve plongé dans le plus incroyable capharnaüm.” ( p 215).
Elle se sent décalée par rapport à son éducation et à ses habitudes, en tant qu’occidentale et en tant que femme:
” Zahr sent la colère l’envahir : cette gamine est vraiment trop sotte! Accepter d’épouser un parfait inconnu! Si encore, comme en Europe, elle pouvait divorcer, mais, ici, le mariage c’est pour la vie. A moins, bien sûr, que l’homme, seigneur et maître absolu, n’en décide autrement” ( 234).
Elle ne trouve pas non plus le sens de la famille qu’elle espérait.
Le jardin est l’endroit qui lui tient à cœur et la jeune femme vient s’y ressourcer :
(Le père) “- (…) il faudra arracher ces manguiers, ils gâchent la vue que l’on a depuis la terrasse du palais. Je voudrais planter autre chose.
(La fille ) – Arracher mes manguiers? s’écrie Zahr, tremblante d’indignation. Vous n’y pensez pas! Et pour y planter quoi? C’est mon jardin, c’est à moi de décider ce que je veux en faire!
(Le père) – Votre jardin? Je ne vous connaissais pas ce sens de la propriété! ” ( p 390).
Après maintes désillusions, la jeune femme réussira à construire une personnalité lucide et forte.
Un rien autobiographique, ce roman est empreint de nostalgie et d’intensité, de sensibilité et de clairvoyance.
Ce titre fait partie de ma liste “Titre d’ordre végétal” » ici