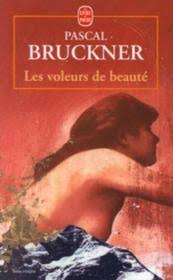
Pascal Bruckner, Les voleurs de beauté
Le livre de poche 1997, 248 p
Il y a ici deux récits entremêlés : la docteure (Mathilde Ayachi) face à son patient (Benjamin Tholon). En suivant l’histoire de Mathilde, on écoute avec elle, celle de Benjamin. Sous forme d’un témoignage qui paraît authentique, les confessions du malade vont changer la vie de la psychiatre.
Benjamin se présente comme un « détrousseur d’ouvrages » faisant de ses plagiats un palimpseste qui le rend célèbre. Il « décroche » par la même occasion Hélène qui représente pour lui « l’esprit français par excellence : l’art […] de de considérer gravement les choses légères et légèrement les choses graves » (p 60). Cependant, la situation ayant périclité (comme on va le voir après), il se retrouve à l’Hôtel Dieu face au Docteur Ayachi.
Mathilde Ayachi veut sortir d’une situation amoureuse délétère : « J’étais passée de la duplicité paternelle à la fausseté amoureuse : dans les deux cas, j’étais suspendue aux fictions d’un homme et ne savais plus quel crédit accorder aux mots » (p 80). Elle finit par écouter Benjamin qui s’incruste après avoir été invité à se raconter.
L’histoire que lui relate cet être déchu – déjà mal parti – est celle de Jérôme Steiner : un « Casanova sénile tombant amoureux d’une femme plus jeune qui lui renvoie la cruauté dont il a usé toute sa vie envers d’autres » (p 131). Il s’agit d’un vieux beau lubrique et de ses deux « cafards » : Francesca Spazzo, la vieille belle pute et Raymond, le nain pervers.
Le trio pense que la beauté est une insulte. Leur vengeance prend la forme d’un sophisme malsain et d’un fanatisme intégriste ignoble. En bref, à trois, ils kidnappent de belles personnes (la mixité est revendiquée mais curieusement il n’y a que des jeunes filles qui sont enlevées) pour les punir : « Elle est enfermée pour expier le crime d’être belle ! ( ) pour les mettre [les jolies femmes] hors d’état de nuire. Elles acquittent l’impôt du visage » (p 139). La punition infligée est la relégation qui seule suffit à les dégrader puisque « ce qui enlaidit nos captives ? Que personne ne les voie. […] Nous les soumettons à l’opprobre suprême : l’invisibilité » (p 144).
Ils vont jusqu’à prôner des convictions soi-disant bienveillantes voire salutaires : « Est-ce que ces jeunes filles se rendent compte de la chance que nous leur offrons ? Échapper à l’obsession de l’image, aux diktats de la mode (…) Elles voulaient être aimées pour elles-mêmes ? Elles sont servies ! ». Elles sont un « fléau pour les autres mais aussi pour elles même » (p 149). Et puisqu’elles ne sont pas heureuses, les tortionnaires leur offrent la rédemption.
En fait, ils dévoilent leurs propres complexes, déceptions et jalousie : « des yeux qui ne disaient pas la colère mais l’appétit, l’envie… » (p 191) et « Ces profanateurs étaient des adorateurs déçus : ils stigmatisaient des grâces et des atours qui les enivraient (p 193).
Ils arrivent à convaincre Benjamin et à l’associer finalement à leur « croisade contre un mythe » (p 186) : « Moi aussi désormais je hais la beauté car elle me réfute » (p 185), dit-il enfin. Il s’y associe d’autant plus que ces jeunes femmes sont forcées de « vieillir avant l’âge comme lui, et sans compassion » (p 200), comme lui !
Le Fanoir (lieu de la réclusion au titre évocateur) est abandonné (après la défection de Raymond ?). Mathilde s’y rend et y passe trois nuits cloîtrée pour réfléchir (p 243) dans une attitude de trouble profond.
La fin et la conclusion sont en demi-teinte : la jeune docteure, en manque de motivation pour son travail découvre « la joie perverse de ne pas vouloir guérir mes patients, de les entretenir dans leurs névroses. J’aime qu’ils aient besoin de moi » (p 247). Ce n’est donc pas une vocation positive mais plutôt négative qui se met en place. Quant aux trois acolytes, on ne sait pas s’ils ont été arrêtés et si leur système a été démonté ou déplacé ailleurs, avec d’autres adeptes ?
Le sujet abordé est non seulement perturbant à cause de l’intrigue mais aussi par les questions qu’il soulève. Aucune réponse n’est donnée et la conclusion est aussi déroutante : pas de fin réelle, pas de morale, pas de rédemption ni de jugement. Le lecteur/lectrice reste seul.e avec ses interrogations, ses doutes et ses illusions. C’est un sujet de toute actualité dans les sociétés ancrées sur l’apparence.
Entre vérité et affabulation, désirs et frustrations, dérive et passage à l’acte, l’antihéros est au cœur de la société.
Citation : « J’ai saisi alors que la chair est limitée au contraire de la pensée. S’attacher à la première, c’est pactiser avec la routine, cultiver la seconde, c’est lui résister, transcender l’existence insignifiante » (p 209).
C’est ce que Benjamin dit.