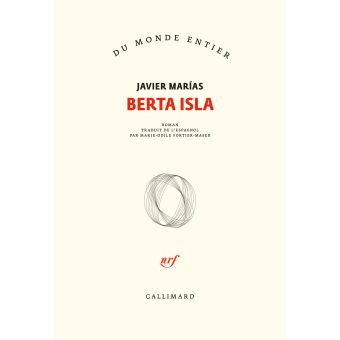
Javier Mariás, Berta Isla
NRF, Gallimard, 587 p,
Livre reçu dans le cadre de La Communauté Culturelle Leclerc.
Le récit commence avec Berta et passe du « elle » au « je ». Il alterne ensuite avec Tomás (Thomas / Tom) et passe de la même manière du « il » au « je ». Ainsi, le roman entrelace la vie et la voix de la femme avec ses multiples interrogations, frustrations, conjectures et fantasmes, et celles de son mari avec les conséquences de son choix.La longue mise en place raconte la jeunesse des deux protagonistes dans une période chargée historiquement : en Espagne, c’est la fin de l’ère franquiste et en France, c’est la révolte des étudiants, Berta a 18 ans en 1969 (Tomás est légèrement plus âgé). Ils profitent d’une liberté sexuelle à la mode, dans un pays où la dictature a fait régner une justice aléatoire ou commanditée. Ces deux facteurs vont se refermer comme un piège sur Tomás.
Au début, les phrases sont longues et ralentissent la lecture, retiennent l’impatience et retardent les événements (elles deviennent plus courtes ensuite). L’écrivain espagnol fait référence à Faulkner dont les phrases « s’étiraient sur des kilomètres » (p 434). Lequel aurait répondu qu’il n’était « jamais sûr d’être encore en vie pour commencer la suivante ». Berta dit qu’il en allait de même pour elle et qu’elle « avait peur de mourir ou, plutôt (…) de tuer Tomás ». Javier Mariás s’associe-t-il donc à Faulkner ?
Quoi qu’il en soit, il faut attendre la page 195 pour que « l’incident » survienne et déclenche la prise de conscience de Berta. Jusque-là, elle vit dans l’île (en effet) qu’elle a circonscrite dès son adolescence, ignorant la vie réelle de son mari. Les menaces des Kindelán la pousse à demander des explications qu’elle n’obtient que partiellement. Tomás ne lui dira jamais qu’il a été l’objet d’une manipulation (meurtre de Janet) qui l’a forcé à devenir « personne », seule façon de devenir « Quelqu’un », afin de se tirer de ce mauvais pas. Commencent alors une vie et un temps parallèles, une moitié de vie pour une Pénélope qui attend son Ulysse.
La mise en place patiente et les phrases travaillées s’accompagnent tout au long du roman d’expressions récurrentes. Des images telles que « banni de l’univers », « le gosier de la mer », « l’air mort » (et quelques autres) reviennent périodiquement. Elles forment un réseau de leitmotiv lancinant qui enferme le récit dans une boucle funeste, en quelque sorte, sans échappatoire. Ces citations proviennent principalement de T. S. Eliot mais il y a de nombreuses références à des écrivains qui viennent étayer les réflexions de l’auteur érudit sur les thèmes qu’il développe.
Ce n’est un roman d’espionnage mais un roman sur l’espionnage, ou plutôt sur les effets sur le couple d’un engagement tel que l’espionnage. La définition de l’homme selon laquelle l’agent secret est une sentinelle œuvrant pour la sécurité du pays s’affronte à la celle de la femme qui pense que cette version n’est qu’un boniment pseudo-patriotique. Le couple est en suspens, face au secret. Quant au concept selon lequel on peut choisir sa vie, l’auteur le décrit comme une notion moderne et subjective : en ne se rebellant pas contre la vie qu’on lui a imposée, l’homme l’a finalement acceptée (et appréciée par moments, selon ses aveux).
« Ainsi en va-t-il de ces vies qui, (…) se contentent d’exister et d’attendre ». J’ajouterai pour finir que pour Tomás, il convient d’attendre pour exister.
Citations:
“Elle avait eu, comme une autre, son histoire d’amour, et que j’en sois l’objet, vivant ou mort.”p 547
“Nous naissons avec les défunts: voyez-les revenir et, avec eux, nous-mêmes.” p 569